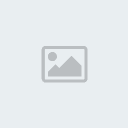Source
http://perso.orange.fr/iledere/bagnards01.htmSaint Martin de Ré sur la route du bagne...
De 1852, date où se met en place la transportation vers les bagnes d'outremer, à 1938, date des dernier départs pour la Guyane, environ 100 000 condamnés firent route vers la Nouvelle Calédonie et surtout vers la Guyane.
L'italien "bagno" (bain) serait à l'origine étymologique du mot bagne. On en trouve des explications assez diverses. La plus connue est que durant le Moyen Age, les pirates barbaresques enfermaient leurs prisonniers dans des bains publics avant de les vendre comme esclaves.
C'est en 1748 que les bagnes ont pris place suite à la suppression des galères. Le 1e fut Toulon où il y avait plus de 4 000 bagnards en 1836. Arrivé au bagne le nouveau bagnard était enchaîné, "accouplé" pour trois ans avec un ancien.
Il y a trois types de condamnés au bagne :
1°) Les transportes soumis au doublage
Ce sont les condamnés par cour d'assise pour meurtre, vol à main armée, qui échappent à la peine de mort mais sont soumis aux travaux forcés. La loi de 1854 impose le terrible doublage qui oblige les condamnés à une peine inférieure à 8 ans à rester autant d'années en Guyane que ce temps de peine, et les condamnés à un temps plus long à rester jusqu'à leur mort sur la terre de bagne.
2°) Les déportés Politiques
Ils sont condamnés pour complot, espionnage, trahison, désertion ou faux-monnayage. Déportés simples, ou condamnés à être détenus en enceinte fortifiée, ils allaient soit en Nouvelle Calédonie, soit en Guyane comme Dreyfus à l'Île du Diable.
3°) Les Rélégués
C'est le sort de ces bagnards qui émut le plus l'opinion publique. Ils étaient envoyés, après un temps de prison au bagne à vie, pour des délits souvent bien mineurs, mais parce qu'ils étaient récidivistes. Les multirécidivistes représentent la moitié des cas jugés vers 1875 ! Il suffisait par exemple d'avoir eu "4" condamnations à plus de 3 mois de prison pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage publique à la pudeur, vagabondage ou mendicite.
Le dépôt de Saint Martin en Ré, une étape obligatoire :
Les condamnés partent de Rennes, Caen ou Fontevrault et sont acheminés par le train, les fers aux pieds, en wagons cellulaires de 19 places vers la prison de la Rochelle. Après 1933, des fourgons permettront d'acheminer en 48 heures près de 400 forçats en 40 véhicules.
Après une nuit à la prison de La Rochelle, les forçats embarquent pour Saint Martin, à bord des bateaux à vapeur de la liaison régulière, l'Express, le Coligny, dans un premier temps au vieux port, puis à La Pallice. Il y eut une évasion pendant une traversée en 1929, celle du relégué Ghiglione qui se jeta à la mer mais fut récupéré peu après, grelottant près d'une voie ferrée !!
Arrivé à St Martin, le convoi débarque sur le quai Clémenceau, surveillé par la gendarmerie et les tirailleurs sénagalais de l'Île, et sous le regard des nombreux curieux. Puis les condamnés se rendent à pied, par "l'allée des soupirs", à la citadelle, devenue en 1873 dépôt d'étape. Là, chacyn est fouillé, perd son identité pour un matricule porté sur le bras gauche. Chacun reçoit des effets neufs (une vareuses de laine, deux chemises, deux paires de souliers) et une couverture.
La vie au dépôt de Saint Martin :
L'administration pénitentiaire partage avec une garnison militaire l'ancienne citadelle reconstruite par Vauban. Les relations ont été parfois tenues, et les anecdotes sont nombreuses à propos de mots de passe oubliés ou de sentinelles endormies.
Les condamnés au bagne peuvent séjourner plusieurs mois à St Martin avant qu'il n'y ait un départ. Séznec y resta près d'un an. Il fit venir sa femme et ses enfants qui fréquentèrent l'école communale. Alfred Dreyfus, accusé de haute trahison, fut incarcéré à Saint Martin du 18 janvier au 21 février 1895, avec des mesures de sécurité renforcées pour prévenir évasion, suicide et même communication avec l'intérieur ou l'extérieur de la citadelle.
Les journées sont rythmées par deux promenades dans la cour, au pas cadencé. Les détenus sont fouillés au coucher. Il y a quatre rondes par nuit,. L'appel est fait deux fois par jour. Contrairement au transporté, le relégué forçat à vie, peut fumer, n'est pas astreint au silence, et peut garder barbe et cheveux. Il peut écrire une lettre par semaine, au lieu d'une par mois. Le jeudi et le Dimanche des visites de parents, durant 20 minutes, sont autorisées.
Le travail dans les ateliers est obligatoire :
Soit l'administration achète matières premières et outillages et paie les détenus, soit une entreprise obtient une concession. Les productions sont variés, émouchettes pour les chevaux de l'armée, sacs en papiers ou en toile, charpillage, étoupe, camails, fabrication de chaussons, cordonnerie, et même vers 1920, préparation de plumes alors que cette activité était supprimée à Fresnes pour nocivité.
L'état de santé des détenus n'est pas très bon. D'après un rapport du docteur Hernette en 1930, les rélégués, qui ne sont pas à leur premier séjour en prison, sont souvent atteints de tuberculose osseuse ou pulmonaire et de maladies vénériennes. L'infirmerie de 30 lits est nettement insuffisante. Ne partent en Guyane que les valides, or 80 relegués n'ont pu partir en 1930 pour raison de santé.
Préparation au départ :
Quinze jours avant le départ, pour qu'ils supportent mieux le voyage puis le climat tropical, les forçats sont mis au repos. Le temps des promenades est allongé, la nourriture amélioré avec de la viande 4 fois par semaine et un quart de vin. Après une douche, une visite médicale décide de l'aptitude au voyage et les forçats sont vaccinés contre la typhoïde et la variole.
Les objets personnels restent à la disposition des familles, et seront donnés à l'hôpital de Saint Martin s'ils ne sont pas récupérés au bout d'un an. Bijoux, argent, suivront les condamnés mais sous la garde de l'administration, à moins que le détenu n'ait réussi à cacher de l'argent dans un "plan" (tube caché dans l'anus)
Le départ...
Les visites ne sont plus autorisées, les punitions sont suspendus. Au petit matin, on distribue à chacun une musette et un grand sac de toile, une gamelle, un quart, une fourchette et une cuillère, un pantalon et une veste en chaud droguet marron et un autre ensemble en toile, deux chemises, des sabots-galoches, et une couverture. Les transportés auront l'obligation de porter le bonnet tandis que les relégués ont droit au chapeau. Les tireurs sénégalais sont prêts, l'heure du départ est arrivée.
Les condamnés avec leur paquetage sont rassemblés en ligne dans la cour pour la bénédiction du curé ou du pasteur avant de franchir les portes de la citadelle. En tête du convoi, marchent les forçats réputés dangereux entourés de baïonnettes avec fers au poignet.
Voici le témoignage de Dieudonné, anarchiste condamné au bagne soupçonné d'avoir agi avec la bande à Bonnot.
"Le bagne de St Martin s'éveille dans un bruit inaccoutumé. Chacun cause bruyamment au nez des gardiens, contents de ce départ qui va leur donner quelques semaines de répit. 400 forçats et 200 relégués sont maintenant dans la cour. Ce n'est pas une mince affaire que de les mettre en ordre 4 par 4.
L'appel n'en finit plus. Au dernier moment, on fait sortir des cachots les fortes têtes. La grand lumière du jour les aveugle. Ils sont pâles et maigres et leurs jambes flageolent. Eux seuls, sont enchaînés.
Tous les gardiens de Ré, tous les surveillants militaires présents, une compagnie de soldats encadrent le convoi. On ouvre les portes. Le long convoi s'ébranle, silencieux. Il repasse les petites portes basses des murs d'enceinte, traverse la cour de la caserne, franchit les hautes portes d'entrée du corps de garde.
Et voici la route jolie. Les journaux ont annoncé le départ, la route est pleine de monde, curieux ou parents...
Morne, le convoi s'avance au milieu de la foule muette. Quelques uns baissent la tête pour cacher des yeux mouillés."
Le Grand Voyage :
Au début du bagne, la Marine Nationale transporte les condamnés vers la Guyane ou la Nouvelle Calédonie sur de vieux vaisseaux de guerre en bois que les cuirassés avaient rendus inutiles. On mettait alors plus de trois mois pour aller en Guyane, et 5 mois pour aller en Nouvelle Calédonie.
Les bagnards avant l'embarquement, inscrivaient des initiales, un mot, un nom...
Les conditions sont si déplorables, que la Marine fit construire deux bateaux adaptés, le Magellan et le Calédonien transportant 450 marins, soldats, 66 officiers et 400 condamnés parqués dans les batteries hautes et basse, dans des cages grillagées, seulement équipés d'un banc de bois fixe et d'un hamac pour deux. Les fers sont toujours utilisés. Les hommes punis avaient les mains attachées derrière le dos à un barreau.
Puis le seul bateau bagne jusqu'aux derniers transports en 1938 fur le LA MARTINIERE, ex Duala, navire allemand de 120m, construit en 1912 à Liverpool, cédé à la France selon les clauses de l'armistice.
Mal de mer, hygiène insuffisante surtout sous les climats chauds, rendaient la traversée pénible. Les incidents étaient rares. Coups de corde devant tous les bagnards, "cellules chaudes", placées au dessus des chaudières, ou même jets de vapeur, les calmaient vite.
" Il fait une chaleur épouvantable car on a fermé les hublots. A travers eux on voit la forêt vierge et impressionnante. On aperçoit les premières maisons avec leur toit de tôle ou de zinc... Trois coups de sirène nous apprennent qu'on arrive, puis tout bruit de machine s'arrête... Les surveillants ouvrent la porte de la cage et nous range par trois... Alignés sur le pont on nous dirige vers la passerelle... Une foule bigarée nous regarde, curieuse... Des noirs, des demi-noirs, des indiens, des chinois, des épaves de blancs (ces blancs doivent être des bagnards libérés)... De l'autre côté des surveillants, des civils bien vêtus, des femmes en toilette d'été, des gosses, tous avec le casque colonial sur la tête.
Nous marchons à peu près 10 minutes et nous arrivons devant une porte en madrier, très haute, où est écrit : Pénitentier de Saint-Laurent-du-Maroni, capacité 3000 hommes..."
Récit de Henri Charrière dit Papillon, arrêté en 1930





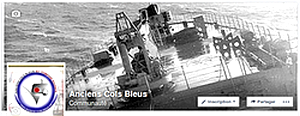
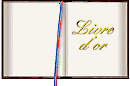




 par
par 






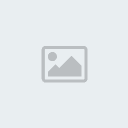

 OUAF,, ouaf.....
OUAF,, ouaf.....