![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238947](/users/2913/33/99/84/smiles/238947.gif)
RESTRICTION D’ACCÈS
Toute personne demandant son inscription sur le forum, et n'étant pas ancien de la Marine Nationale, se verra refuser l'accès, mais pourra contacter le forum. Les matricules devront être correctement inscrits pour ceux qui réunissent les conditions, ceci afin de pouvoir vérifier leur authenticité, et de protéger le forum de toutes intrusions pouvant nuire au bon fonctionnement. Les membres de la famille d'un marin ou les visiteurs intéressés pourront poster leurs questions dans le forum, visiteurs en cliquant sur le lien dudit forum.
Statistiques
Nos membres ont posté un total de 1153080 messages dans 18082 sujets
Nous avons 7972 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est Claude Castelbou
Rechercher
LIVRE D’OR
Derniers sujets
» [ Logos - Tapes - Insignes ] Insignes de spécialités dans la Marine
par PAUGAM herve Hier à 23:39
» [ Histoire et histoires ] ST-NAZAIRE LE PLUS AUDACIEUX RAIDS COMMANDOS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par garcia guy Hier à 21:42
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] TENUE DANS LA MARINE- TOME 05
par QUIQUEMELLE Hier à 20:17
» [Vie des ports] LE PORT DE LORIENT VOLUME 005
par ALAIN 78 Hier à 18:03
» FREMM Normandie (D651)
par Hunault olivier Hier à 17:07
» JEANNE D'ARC (PH) - VOLUME 5
par alain EGUERRE Hier à 16:21
» [ Divers escorteurs d'escadre ] recueil d'époque des chantiers de la GIRONDE
par GARNIER Yves Hier à 15:54
» [ Blog visiteurs ] Exploitation du Concorde à HAO
par GYURISS Hier à 14:55
» [ Blog visiteurs ] rRecherche des informations sur mon grand-père
par Invité Hier à 9:44
» 15 mois à bord du P.A Clemenceau 1965/1966
par Fleury Hier à 9:34
» [ Recherches de camarades ] radios embarquée Clemenceau de juillet 1964 à juillet 1965 et Unité Marine Djibouti de aout 1965 à aout 1967.
par Fleury Hier à 8:58
» [ASSOCIATIONS ANCIENS MARINS] ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS DU NORD-FINISTERE
par BRASSAT Jeu 25 Juil 2024 - 21:05
» [ Blog visiteurs ] Recherche infos sur l'histoire de mon père qui a servi dans la marine de 1952 à 1965
par Invité Jeu 25 Juil 2024 - 20:45
» [ Histoire et histoires ] Et si nous participions à la sauvegarde du Maillé Brezé ?
par Dutertre Jeu 25 Juil 2024 - 13:51
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] LES RUBANS LÉGENDÉS
par douzef Jeu 25 Juil 2024 - 13:22
» [Les ports militaires de métropole] Port de LORIENT - TOME 2
par alain EGUERRE Jeu 25 Juil 2024 - 10:46
» VINLONGH (DM)
par Matelot Jeu 25 Juil 2024 - 6:31
» [Autre sujet Marine Nationale] Démantèlement, déconstruction des navires - TOME 2
par Jean-Marie41 Mer 24 Juil 2024 - 17:46
» [Vie des ports] BREST Ports et rade - Volume 001
par JACQUES SOUVAY ou BILL Mer 24 Juil 2024 - 17:27
» [ Blog visiteurs ] Demande d'informations
par takeo Mar 23 Juil 2024 - 20:42
» [Votre passage au C.F.M.] Le maniement d'arme à Hourtin !!!
par Kohler Jean Marie(Hans) Mar 23 Juil 2024 - 17:47
» BERLAIMONT (DO)
par Roland LARA Mar 23 Juil 2024 - 16:45
» [ Histoires et histoire ] Le Joffre et le Painlevé
par JJMM Mar 23 Juil 2024 - 9:02
» [Papeete] PAPEETE HIER ET AUJOURD'HUI - TOME 3
par TUR2 Lun 22 Juil 2024 - 20:48
» MINERVE (SM) - TOME 2
par Kohler Jean Marie(Hans) Lun 22 Juil 2024 - 11:32
» [Vie des ports] PORT DE SAINT TROPEZ
par Le moelannais Lun 22 Juil 2024 - 10:04
» [ Les stations radio de télécommunications ] Station radio La Régine
par Max Péron Dim 21 Juil 2024 - 18:00
» [Les batiments auxiliaires] ASTROLABE (Patrouilleur et Navire Logistique Polaire)
par BIGOT Dim 21 Juil 2024 - 16:53
» [LES B.A.N.] TONTOUTA
par MAGUEUR Dim 21 Juil 2024 - 12:40
» [Les stations radio et télécommunications] La station de Kerlouan
par Nenesse Dim 21 Juil 2024 - 12:39
» [Plongeurs démineurs] ACHERON (BB - PLONGEURS DÉMINEURS )
par Le moelannais Dim 21 Juil 2024 - 7:02
» Le navire MN TANGARA
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 19:40
» FLOTTILLE 33 F
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 19:17
» FULMAR P740
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 19:06
» PREMIER MAÎTRE L'HER (AVISO)
par Matelot Sam 20 Juil 2024 - 18:59
» MARINE PAPEETE, ET QUE MARINE PAPEETE !
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 18:59
» [Vie des ports] Port de La Seyne-sur-Mer (83)
par Nenesse Sam 20 Juil 2024 - 18:53
» MISTRAL (PHA)
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 18:53
» [ Divers frégates ] les frégates furtives sans nom sans nunéros
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 18:23
» BSM LORIENT - KEROMAN
par Roland LARA Sam 20 Juil 2024 - 16:04
» [ Associations anciens Marins ] L'AMMAC DE PARAY-ATHIS & ENVIRONS A 60 ANS...
par RENARD-HACHIN Sam 20 Juil 2024 - 15:24
» LE BOULONNAIS (ER)
par BONNERUE Daniel Sam 20 Juil 2024 - 15:10
» Inclinaison de l'insigne de mécano
par douzef Sam 20 Juil 2024 - 14:54
» [ Recherches de camarades ] Recherche camarades du Guépratte (2 novembre 1970 au 4 octobre 1971) et plus particulièrement ceux du service ASM
par boboss Sam 20 Juil 2024 - 12:58
» COURBET F712 (FREGATE)
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 11:19
» [ Blog visiteurs ] Mon grand-père était marin sur l'Émile BERTIN
par Invité Sam 20 Juil 2024 - 0:53
» Jacques Chevallier A725 (Bâtiments ravitailleurs de forces - BRF)
par Hunault olivier Ven 19 Juil 2024 - 20:19
» [LES B.A.N.] LANVÉOC POULMIC
par Joël Chandelier Ven 19 Juil 2024 - 18:51
» [Vieilles paperasses] Vieilles photos de marins - Tome 2
par douzef Ven 19 Juil 2024 - 14:27
» Teriieroo a Teriierooiterai (P780) - Patrouilleur Outre-mer (POM)
par david974 Ven 19 Juil 2024 - 11:23
» [Marins Pompiers] La Loude Y 784
par Franjacq Ven 19 Juil 2024 - 8:12
» VAR (BCR)
par Patrick Fde florence Ven 19 Juil 2024 - 7:12
» [ Blog visiteurs ] Nom du Commandant de la Frégate Surcouf années 2003-2005
par douzef Jeu 18 Juil 2024 - 22:32
» [ Recherches de camarades ] Recherche maistranciers promo maistrance pont 1965-1966
par Autret jos Jeu 18 Juil 2024 - 20:14
» [La musique dans la Marine] LA MUSIQUE DE LA FLOTTE
par Christian DIGUE Jeu 18 Juil 2024 - 15:46
» [Les stations radio et télécommunications] CTM France Sud
par Max Péron Jeu 18 Juil 2024 - 15:31
» TONNERRE (PHA)
par Patrick Fde florence Jeu 18 Juil 2024 - 11:59
» EDIC 9094
par Max Péron Mer 17 Juil 2024 - 18:46
» [Campagnes] DAKAR
par Noël Gauquelin Mer 17 Juil 2024 - 14:28
» [ Divers frégates ] Les FREMM sans Nom sans Numero
par Hunault olivier Mer 17 Juil 2024 - 14:22
» [Divers commandos] Nageurs de combats d'hier et aujourd'hui
par david974 Mer 17 Juil 2024 - 11:08
» Un chant de sous mariniers
par Matelot Mer 17 Juil 2024 - 6:08
» TOURVILLE SNA
par Louis BOUZELOC Mar 16 Juil 2024 - 23:38
» BATIMENTS ÉCOLE TYPE LÉOPARD
par Christian DIGUE Mar 16 Juil 2024 - 18:50
» GARONNE BSAM (Bâtiment de Soutien et d'Assistance Métropolitain)
par Christian DIGUE Mar 16 Juil 2024 - 18:45
» [ Associations anciens Marins ] AMMAC de Cernay (68) et des Vallées Thur-Doller
par Kohler Jean Marie(Hans) Mar 16 Juil 2024 - 11:32
» CYCLAMEN (DC)
par sergeair Mar 16 Juil 2024 - 11:10
» LE TERRIBLE (SNLE)
par comjipe Lun 15 Juil 2024 - 17:31
» LE TRIOMPHANT (SNLE)
par david974 Lun 15 Juil 2024 - 17:00
» EDIC 9070
par gabriel Lun 15 Juil 2024 - 15:50
» FOUDROYANT (SNLE)
par comjipe Lun 15 Juil 2024 - 13:03
» [VOS ESCALES ] Aux USA
par Max Péron Dim 14 Juil 2024 - 16:28
» [Vieilles paperasses] Nos papiers Marine... et rien que papiers marine.
par PAUGAM herve Dim 14 Juil 2024 - 14:45
» [ TOUS LES C.F.M. ET C.I.N. ] C.I.N. BREST
par christian 84 Dim 14 Juil 2024 - 9:19
» [Les écoles de spécialités] ÉCOLE DES FOURRIERS CHERBOURG
par AlainD59 Sam 13 Juil 2024 - 23:39
» [Campagne] DIÉGO SUAREZ - TOME 018
par Jean-Léon Sam 13 Juil 2024 - 11:22
» [Les ports militaires de métropole] Port de BREST - TOME 3
par Nenesse Ven 12 Juil 2024 - 22:40
» Léon Gauthier, 1er Bataillon de Fusiliers-Marins Commandos (1er BFMC) créé au printemps 1942 en Grande-Bretagne par la France libre (FNFL) et commandés par le capitaine de corvette Philippe Kieffer.
par CPM73 Ven 12 Juil 2024 - 14:33
» [Vieilles paperasses] Livret matricule
par lefrancois Ven 12 Juil 2024 - 12:02
» MANINI (RC)
par Jean-Marie41 Jeu 11 Juil 2024 - 18:01
» [Vie des ports] Port de Saint Nazaire
par Max Péron Jeu 11 Juil 2024 - 17:43
» [ Histoires et histoire ] Monuments aux morts originaux Français Tome 2
par takeo Jeu 11 Juil 2024 - 11:34
» [ La S.N.S.M. ] St TROPEZ
par Le moelannais Jeu 11 Juil 2024 - 8:08
» [ PORTE-AVION NUCLÉAIRE ] Charles de Gaulle Tome 4
par Franjacq Mer 10 Juil 2024 - 15:17
» La Combattante (P735) - Patrouilleur Antilles Guyane (PAG)
par Yvon972 Mer 10 Juil 2024 - 14:32
» [ Associations anciens Marins ] Les membres du MESMAT nouvel équipage de la FLORE
par destrez Mar 9 Juil 2024 - 8:32
» [ Blog visiteurs ] Je cherche des traces de mon père André Wahiche
par Invité Lun 8 Juil 2024 - 21:59
» [ Blog visiteurs ] Contre torpilleur "Le Triomphant"
par BEBERT 49 Lun 8 Juil 2024 - 21:42
» [Vie des ports] PORT DE TOULON - VOLUME 004
par Jean-Marie41 Lun 8 Juil 2024 - 18:39
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] LE PORT DES DÉCORATIONS
par HèmBé43 Lun 8 Juil 2024 - 6:59
» [ Blog visiteurs ] LE COURAGEUX
par Invité Dim 7 Juil 2024 - 19:49
» CDT BOURDAIS (AE) Tome 3
par Max Péron Dim 7 Juil 2024 - 16:14
» [ Aéronavale divers ] Quel est cet aéronef ?
par Gibus1750 Dim 7 Juil 2024 - 14:23
» [ Logos - Tapes - Insignes ] ÉCUSSONS ET INSIGNES - TOME 3
par comjota Dim 7 Juil 2024 - 12:54
» [ Divers - Les classiques ] LE CROISEUR SOUS-MARIN SURCOUF
par CHRISTIAN63 Sam 6 Juil 2024 - 14:43
» [ Histoire et histoires ] La fin tragique du cargo LONGWY LE 4 Novembre 1917
par Joël Chandelier Sam 6 Juil 2024 - 13:32
» FREMM Provence (D652)
par david974 Sam 6 Juil 2024 - 13:02
» [ Blog visiteurs ] Je suis possession (en partie) de la liste nominative de la promo Aero et machine et de la liste BS aéro Rochefort promo 59
par jlchaillot Sam 6 Juil 2024 - 8:19
» DIXMUDE (PHA)
par Le moelannais Jeu 4 Juil 2024 - 17:39
par PAUGAM herve Hier à 23:39
» [ Histoire et histoires ] ST-NAZAIRE LE PLUS AUDACIEUX RAIDS COMMANDOS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
par garcia guy Hier à 21:42
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] TENUE DANS LA MARINE- TOME 05
par QUIQUEMELLE Hier à 20:17
» [Vie des ports] LE PORT DE LORIENT VOLUME 005
par ALAIN 78 Hier à 18:03
» FREMM Normandie (D651)
par Hunault olivier Hier à 17:07
» JEANNE D'ARC (PH) - VOLUME 5
par alain EGUERRE Hier à 16:21
» [ Divers escorteurs d'escadre ] recueil d'époque des chantiers de la GIRONDE
par GARNIER Yves Hier à 15:54
» [ Blog visiteurs ] Exploitation du Concorde à HAO
par GYURISS Hier à 14:55
» [ Blog visiteurs ] rRecherche des informations sur mon grand-père
par Invité Hier à 9:44
» 15 mois à bord du P.A Clemenceau 1965/1966
par Fleury Hier à 9:34
» [ Recherches de camarades ] radios embarquée Clemenceau de juillet 1964 à juillet 1965 et Unité Marine Djibouti de aout 1965 à aout 1967.
par Fleury Hier à 8:58
» [ASSOCIATIONS ANCIENS MARINS] ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS DU NORD-FINISTERE
par BRASSAT Jeu 25 Juil 2024 - 21:05
» [ Blog visiteurs ] Recherche infos sur l'histoire de mon père qui a servi dans la marine de 1952 à 1965
par Invité Jeu 25 Juil 2024 - 20:45
» [ Histoire et histoires ] Et si nous participions à la sauvegarde du Maillé Brezé ?
par Dutertre Jeu 25 Juil 2024 - 13:51
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] LES RUBANS LÉGENDÉS
par douzef Jeu 25 Juil 2024 - 13:22
» [Les ports militaires de métropole] Port de LORIENT - TOME 2
par alain EGUERRE Jeu 25 Juil 2024 - 10:46
» VINLONGH (DM)
par Matelot Jeu 25 Juil 2024 - 6:31
» [Autre sujet Marine Nationale] Démantèlement, déconstruction des navires - TOME 2
par Jean-Marie41 Mer 24 Juil 2024 - 17:46
» [Vie des ports] BREST Ports et rade - Volume 001
par JACQUES SOUVAY ou BILL Mer 24 Juil 2024 - 17:27
» [ Blog visiteurs ] Demande d'informations
par takeo Mar 23 Juil 2024 - 20:42
» [Votre passage au C.F.M.] Le maniement d'arme à Hourtin !!!
par Kohler Jean Marie(Hans) Mar 23 Juil 2024 - 17:47
» BERLAIMONT (DO)
par Roland LARA Mar 23 Juil 2024 - 16:45
» [ Histoires et histoire ] Le Joffre et le Painlevé
par JJMM Mar 23 Juil 2024 - 9:02
» [Papeete] PAPEETE HIER ET AUJOURD'HUI - TOME 3
par TUR2 Lun 22 Juil 2024 - 20:48
» MINERVE (SM) - TOME 2
par Kohler Jean Marie(Hans) Lun 22 Juil 2024 - 11:32
» [Vie des ports] PORT DE SAINT TROPEZ
par Le moelannais Lun 22 Juil 2024 - 10:04
» [ Les stations radio de télécommunications ] Station radio La Régine
par Max Péron Dim 21 Juil 2024 - 18:00
» [Les batiments auxiliaires] ASTROLABE (Patrouilleur et Navire Logistique Polaire)
par BIGOT Dim 21 Juil 2024 - 16:53
» [LES B.A.N.] TONTOUTA
par MAGUEUR Dim 21 Juil 2024 - 12:40
» [Les stations radio et télécommunications] La station de Kerlouan
par Nenesse Dim 21 Juil 2024 - 12:39
» [Plongeurs démineurs] ACHERON (BB - PLONGEURS DÉMINEURS )
par Le moelannais Dim 21 Juil 2024 - 7:02
» Le navire MN TANGARA
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 19:40
» FLOTTILLE 33 F
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 19:17
» FULMAR P740
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 19:06
» PREMIER MAÎTRE L'HER (AVISO)
par Matelot Sam 20 Juil 2024 - 18:59
» MARINE PAPEETE, ET QUE MARINE PAPEETE !
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 18:59
» [Vie des ports] Port de La Seyne-sur-Mer (83)
par Nenesse Sam 20 Juil 2024 - 18:53
» MISTRAL (PHA)
par Christian DIGUE Sam 20 Juil 2024 - 18:53
» [ Divers frégates ] les frégates furtives sans nom sans nunéros
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 18:23
» BSM LORIENT - KEROMAN
par Roland LARA Sam 20 Juil 2024 - 16:04
» [ Associations anciens Marins ] L'AMMAC DE PARAY-ATHIS & ENVIRONS A 60 ANS...
par RENARD-HACHIN Sam 20 Juil 2024 - 15:24
» LE BOULONNAIS (ER)
par BONNERUE Daniel Sam 20 Juil 2024 - 15:10
» Inclinaison de l'insigne de mécano
par douzef Sam 20 Juil 2024 - 14:54
» [ Recherches de camarades ] Recherche camarades du Guépratte (2 novembre 1970 au 4 octobre 1971) et plus particulièrement ceux du service ASM
par boboss Sam 20 Juil 2024 - 12:58
» COURBET F712 (FREGATE)
par Le moelannais Sam 20 Juil 2024 - 11:19
» [ Blog visiteurs ] Mon grand-père était marin sur l'Émile BERTIN
par Invité Sam 20 Juil 2024 - 0:53
» Jacques Chevallier A725 (Bâtiments ravitailleurs de forces - BRF)
par Hunault olivier Ven 19 Juil 2024 - 20:19
» [LES B.A.N.] LANVÉOC POULMIC
par Joël Chandelier Ven 19 Juil 2024 - 18:51
» [Vieilles paperasses] Vieilles photos de marins - Tome 2
par douzef Ven 19 Juil 2024 - 14:27
» Teriieroo a Teriierooiterai (P780) - Patrouilleur Outre-mer (POM)
par david974 Ven 19 Juil 2024 - 11:23
» [Marins Pompiers] La Loude Y 784
par Franjacq Ven 19 Juil 2024 - 8:12
» VAR (BCR)
par Patrick Fde florence Ven 19 Juil 2024 - 7:12
» [ Blog visiteurs ] Nom du Commandant de la Frégate Surcouf années 2003-2005
par douzef Jeu 18 Juil 2024 - 22:32
» [ Recherches de camarades ] Recherche maistranciers promo maistrance pont 1965-1966
par Autret jos Jeu 18 Juil 2024 - 20:14
» [La musique dans la Marine] LA MUSIQUE DE LA FLOTTE
par Christian DIGUE Jeu 18 Juil 2024 - 15:46
» [Les stations radio et télécommunications] CTM France Sud
par Max Péron Jeu 18 Juil 2024 - 15:31
» TONNERRE (PHA)
par Patrick Fde florence Jeu 18 Juil 2024 - 11:59
» EDIC 9094
par Max Péron Mer 17 Juil 2024 - 18:46
» [Campagnes] DAKAR
par Noël Gauquelin Mer 17 Juil 2024 - 14:28
» [ Divers frégates ] Les FREMM sans Nom sans Numero
par Hunault olivier Mer 17 Juil 2024 - 14:22
» [Divers commandos] Nageurs de combats d'hier et aujourd'hui
par david974 Mer 17 Juil 2024 - 11:08
» Un chant de sous mariniers
par Matelot Mer 17 Juil 2024 - 6:08
» TOURVILLE SNA
par Louis BOUZELOC Mar 16 Juil 2024 - 23:38
» BATIMENTS ÉCOLE TYPE LÉOPARD
par Christian DIGUE Mar 16 Juil 2024 - 18:50
» GARONNE BSAM (Bâtiment de Soutien et d'Assistance Métropolitain)
par Christian DIGUE Mar 16 Juil 2024 - 18:45
» [ Associations anciens Marins ] AMMAC de Cernay (68) et des Vallées Thur-Doller
par Kohler Jean Marie(Hans) Mar 16 Juil 2024 - 11:32
» CYCLAMEN (DC)
par sergeair Mar 16 Juil 2024 - 11:10
» LE TERRIBLE (SNLE)
par comjipe Lun 15 Juil 2024 - 17:31
» LE TRIOMPHANT (SNLE)
par david974 Lun 15 Juil 2024 - 17:00
» EDIC 9070
par gabriel Lun 15 Juil 2024 - 15:50
» FOUDROYANT (SNLE)
par comjipe Lun 15 Juil 2024 - 13:03
» [VOS ESCALES ] Aux USA
par Max Péron Dim 14 Juil 2024 - 16:28
» [Vieilles paperasses] Nos papiers Marine... et rien que papiers marine.
par PAUGAM herve Dim 14 Juil 2024 - 14:45
» [ TOUS LES C.F.M. ET C.I.N. ] C.I.N. BREST
par christian 84 Dim 14 Juil 2024 - 9:19
» [Les écoles de spécialités] ÉCOLE DES FOURRIERS CHERBOURG
par AlainD59 Sam 13 Juil 2024 - 23:39
» [Campagne] DIÉGO SUAREZ - TOME 018
par Jean-Léon Sam 13 Juil 2024 - 11:22
» [Les ports militaires de métropole] Port de BREST - TOME 3
par Nenesse Ven 12 Juil 2024 - 22:40
» Léon Gauthier, 1er Bataillon de Fusiliers-Marins Commandos (1er BFMC) créé au printemps 1942 en Grande-Bretagne par la France libre (FNFL) et commandés par le capitaine de corvette Philippe Kieffer.
par CPM73 Ven 12 Juil 2024 - 14:33
» [Vieilles paperasses] Livret matricule
par lefrancois Ven 12 Juil 2024 - 12:02
» MANINI (RC)
par Jean-Marie41 Jeu 11 Juil 2024 - 18:01
» [Vie des ports] Port de Saint Nazaire
par Max Péron Jeu 11 Juil 2024 - 17:43
» [ Histoires et histoire ] Monuments aux morts originaux Français Tome 2
par takeo Jeu 11 Juil 2024 - 11:34
» [ La S.N.S.M. ] St TROPEZ
par Le moelannais Jeu 11 Juil 2024 - 8:08
» [ PORTE-AVION NUCLÉAIRE ] Charles de Gaulle Tome 4
par Franjacq Mer 10 Juil 2024 - 15:17
» La Combattante (P735) - Patrouilleur Antilles Guyane (PAG)
par Yvon972 Mer 10 Juil 2024 - 14:32
» [ Associations anciens Marins ] Les membres du MESMAT nouvel équipage de la FLORE
par destrez Mar 9 Juil 2024 - 8:32
» [ Blog visiteurs ] Je cherche des traces de mon père André Wahiche
par Invité Lun 8 Juil 2024 - 21:59
» [ Blog visiteurs ] Contre torpilleur "Le Triomphant"
par BEBERT 49 Lun 8 Juil 2024 - 21:42
» [Vie des ports] PORT DE TOULON - VOLUME 004
par Jean-Marie41 Lun 8 Juil 2024 - 18:39
» [LES TRADITIONS DANS LA MARINE] LE PORT DES DÉCORATIONS
par HèmBé43 Lun 8 Juil 2024 - 6:59
» [ Blog visiteurs ] LE COURAGEUX
par Invité Dim 7 Juil 2024 - 19:49
» CDT BOURDAIS (AE) Tome 3
par Max Péron Dim 7 Juil 2024 - 16:14
» [ Aéronavale divers ] Quel est cet aéronef ?
par Gibus1750 Dim 7 Juil 2024 - 14:23
» [ Logos - Tapes - Insignes ] ÉCUSSONS ET INSIGNES - TOME 3
par comjota Dim 7 Juil 2024 - 12:54
» [ Divers - Les classiques ] LE CROISEUR SOUS-MARIN SURCOUF
par CHRISTIAN63 Sam 6 Juil 2024 - 14:43
» [ Histoire et histoires ] La fin tragique du cargo LONGWY LE 4 Novembre 1917
par Joël Chandelier Sam 6 Juil 2024 - 13:32
» FREMM Provence (D652)
par david974 Sam 6 Juil 2024 - 13:02
» [ Blog visiteurs ] Je suis possession (en partie) de la liste nominative de la promo Aero et machine et de la liste BS aéro Rochefort promo 59
par jlchaillot Sam 6 Juil 2024 - 8:19
» DIXMUDE (PHA)
par Le moelannais Jeu 4 Juil 2024 - 17:39
DERNIERS SUJETS
[Vie des ports] Les ports de la Réunion

salonais- MATELOT

- Age : 79
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 MECANEQUI](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/MECANEQUI.jpg)

- Message n°326
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Hé,Alain,ton polonais ne veux pas deroger a sa réputation! ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238947](/users/2913/33/99/84/smiles/238947.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238947](/users/2913/33/99/84/smiles/238947.gif)

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) A l'au-delà je préfère le vin d'ici.
A l'au-delà je préfère le vin d'ici.AQI SIAN BIAN
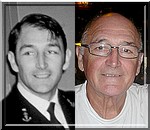
PAUGAM herve- QM 1

- Age : 80


![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Monite10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/monite10.gif)
- Message n°327
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Et pour l'eau , il a fait comment ce Polonais ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)

(Pierre Dac)
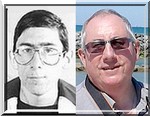
takeo- ADMINISTRATEUR

- Age : 62

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Aero10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/aero10.jpg)
- Message n°328
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Belle série Alain ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanreconnaissance](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/rubanreconnaissance.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insig205](https://i.servimg.com/u/f39/15/16/88/33/insig205.gif)
*De temps à autre, un retour aux sources ou à nos racines s'impose pour retrouver ce qui jadis fut familier et siège pour toujours dans notre cœur *
[Loreena McKennitt]
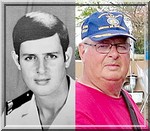
alain EGUERRE- MAÎTRE

- Age : 74


- Message n°329
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
La trouée de la rivière des galets vue du port
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_130](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_130.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_130](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_130.jpg)
- Spoiler:
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_129](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_129.jpg)
A gauche la roche écrite (2276m)![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_128](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_128.jpg)
On aperçoit les maisons de Dos d’Âne à l’entrée du cirque de Mafate![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_134](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_134.jpg)
Anciennes baleinières du caseilleur l'Austral![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_135](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_135.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_137](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_137.jpg)
Comme du coté militaire, il n'y a pas foule dans la darse des pêcheurs des TAAF![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_136](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_136.jpg)
L'Ile de la Réunion qui désormais sera le patrouilleur des Affaires Maritimes en remplacement de l'Osiris![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_139](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_139.jpg)
Et le palangrier Croix du Sud resté à quai !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_138](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_138.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_141](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_141.jpg)
Arrêt technique pour l'Austral
Personne le dimanche alors j'en profite pour aller sur le quai de la Sapmer![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_140](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_140.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_142](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_142.jpg)
Je vais pouvoir l'observer de près![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_144](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_144.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_145](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_145.jpg)
L'Astrolabe, seul dans la darse militaire !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_143](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_143.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_152](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_152.jpg)
La passerelle![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_150](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_150.jpg)
Détails !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_151](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_151.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_153](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_153.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_155](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_155.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_154](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_154.jpg)
Je n'étais jamais venu jusqu'ici, la darse des phares et balises![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_157](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_157.jpg)
Vedette du pilote, des Affaires Maritimes etc...![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_158](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_158.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_156](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_156.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_159](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_159.jpg)
L'ancien hangar à grain devant l’entrée du port Ouest !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_160](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_160.jpg)
Effet d'optique l''entrée est bien plus large car à notre époque des années 70, les cargos venaient ici !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_161](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_161.jpg)
Ils ont été remplacés par la flotte de palangriers sous pavillon des Kerguelen![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_162](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_162.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_163](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_163.jpg)
L'Austral de face, une première pour moi![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_164](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_164.jpg)
Ce quai est interdit aux visiteurs la semaine pour cause de travail !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_165](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_165.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_167](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_167.jpg)
Détails, j'en profite !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_166](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_166.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_168](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_168.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_169](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_169.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_170](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_170.jpg)
A suivre
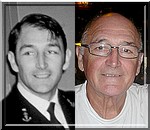
PAUGAM herve- QM 1

- Age : 80


![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Monite10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/monite10.gif)
- Message n°330
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
A part les deux personnes sur les dernières photos, et toi, il n'y a pas âme qui vive sur les quais !
Imagine le même scénario au marché Saint-Pierre, Alain.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 180328](/users/2913/33/99/84/smiles/180328.gif)
Imagine le même scénario au marché Saint-Pierre, Alain.
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 180328](/users/2913/33/99/84/smiles/180328.gif)

(Pierre Dac)

† COLLEMANT Dominique- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 77


- Message n°331
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Peut être que c'était l'heure de la sieste.... ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanreconnaissance](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/rubanreconnaissance.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insign10](https://i.servimg.com/u/f58/15/16/88/33/insign10.gif)
Maître Principal mécanicien Collemant , dit "Bill" dans la sous-marinade / Membre de la section A.G.A.S.M. "Espadon" du Havre / Membre du M.E.S.M.A.T. de Lorient .
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Floreb10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/floreb10.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Maistr10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/maistr10.jpg)

salonais- MATELOT

- Age : 79
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 MECANEQUI](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/MECANEQUI.jpg)

- Message n°333
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
J'aime bien "l'ile de la réunion",il doit etre agréable a naviguer !

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) A l'au-delà je préfère le vin d'ici.
A l'au-delà je préfère le vin d'ici.AQI SIAN BIAN

Bureaumachine busset- MATELOT

- Age : 67
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 MECANEQUI](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/MECANEQUI.jpg)

- Message n°334
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Alain ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) Sympa beaux reportages
Sympa beaux reportages
Ils étaient tous à l’apero![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 26540](/users/2913/33/99/84/smiles/26540.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) Sympa beaux reportages
Sympa beaux reportages Ils étaient tous à l’apero
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 26540](/users/2913/33/99/84/smiles/26540.gif)
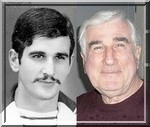
sad5- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 73


- Message n°335
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 762739](/users/2913/33/99/84/smiles/762739.gif) Alain et
Alain et ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 588638](/users/2913/33/99/84/smiles/588638.gif) Superbes photos, riches en détails !
Superbes photos, riches en détails ! ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 642994](/users/2913/33/99/84/smiles/642994.gif)
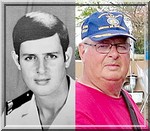
alain EGUERRE- MAÎTRE

- Age : 74


- Message n°336
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
L'Autral, caseyeur congélateur des TAAF
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_205](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_205.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_205](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_205.jpg)
- Spoiler:
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_206](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_206.jpg)
Détails de la passerelle découverte![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_208](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_208.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_209](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_209.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_218](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_218.jpg)
L'Astrolabe derrière l'étrave de l'Austral !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_219](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_219.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_221](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_221.jpg)
La Sapmer, armateur de l'Austral![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_220](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_220.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_222](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_222.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_224](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_224.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_223](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_223.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_225](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_225.jpg)
Port d'attache : Port aux français, Kerguelen![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_226](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_226.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_227](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_227.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_228](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_228.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_229](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_229.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_230](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_230.jpg)
Les îles subantarctiques La langouste australe le samedi, 10 avril 2010 par le sénateur Christian Gaudin
Nous sommes arrivés vendredi soir sur Amsterdam et avons enchaîné par une visite technique de la base. Ce matin, samedi, mon programme est de visiter le navire langoustier l’Austral qui est le seul navire à avoir le droit de pêcher langoustes et poissons dans la ZEE (zone économique exclusive) de St-Paul et Amsterdam. La pêche est finie depuis deux jours et très aimablement le capitaine nous a attendus pour nous permettre de visiter son navire armé par la SAPMER.
Un zodiaque vient nous chercher à la cale, au pied de la base, et nous voilà partis.
Michel Le Glatin, le Capitaine, n’est pas un marin d’eau douce, plus de 30 ans de pêche australe à son actif comme matelot, lieutenant, second et capitaine depuis un peu plus de dix ans. Il nous fait les honneurs du bord.
L’Austral est un ancien chalutier qui a été transformé pour la pêche à la langouste. C’est un navire de plus de 60 m avec un équipage de 50 marins environ.
Le TAC (total admissible de capture) de 400 tonnes est partagé en deux quotas, l’un pour la langouste côtière, l’autre pour la langouste de fond. Il est réparti entre les deux petits caseyeurs et les quatre doris du bord. Chaque embarcation a son propre patron et son équipe. Chacun est rémunéré, en plus du SMIC pêche légal, à la part de pêche de son embarcation. Tout le monde marche au mérite. Ne devient chef de pêche que celui qui a fait ses preuves et sait amener les autres dans « les bons coins ».
Une fois pêchée, la langouste est triée et traitée. Le premier tri est légal : le poids réglementaire. Aucune langouste de moins de 150 g n’est conservée (Jasus Paulensis est plus petite que la bretonne). Le reste est traité en fonction de la demande des clients : calibrage précis, cuite ou crue, entière ou étêtée. Je suis vraiment impressionné par le dispositif du bord. A sa sortie de l’Austral, la langouste est déjà conditionnée pour les restaurants. Chaque langouste est ensachée individuellement. Des colis de deux fois 5 kg sont préparés. A chaque caisse correspond un calibre particulier. Le poids est exact à 10 g près maximum. Je mesure combien les conditions de vie à bord son éprouvantes avec de longues journées et des cadences soutenues.
L’Austral a aussi une activité de pêche sur quelques poissons de la zone. C’est plus un complément qu’un véritable but, compte tenu des objectifs de rentabilité.
La visite s’achève par un long échange dans la cabine du capitaine autour d’un céviche de langouste et d’un verre de blanc. Le contrôleur de pêche, une femme, nous rejoint ainsi que le Commandant Courtes, et nous devisons plus d’une heure tous ensemble sur la pêche ici et ailleurs. Un excellent moment plein de vérité humaine grâce à l’hospitalité légendaire du patron de l’Austral.
Cette visite ouvre pour moi plusieurs pistes de travail :
La pêcherie langouste paraît bien gérée. Elle repose sur l’avis scientifique du Muséum et, me semble-t-il, sur l’écoute attentive des pêcheurs. Ce dialogue est absolument essentiel.
Je me demande pourquoi cette pêcherie n’est pas encore labellisée MSC (Marine Stewardship Council, un organisme international de labellisation des pêcheries durables) puisque la traçabilité et les contrôles sont parmi ce qui se fait de mieux.
Par contre, il n’y a pas de pêche scientifique de la langouste : tout repose sur les données de pêche certifiées par les contrôleurs. Cela me semble être une faiblesse.
Plus encore, j’apprends qu’un TAC sur les poissons de la zone est alloué sans qu’il y ait de campagne scientifique d’évaluation de la biomasse. Je suis vraiment étonné.
Je suis également surpris qu’en dehors des eaux territoriales aucun banc ne soit classé en aire marine protégée.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_231](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_231.jpg)
Deux anciens doris désarmés !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_233](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_233.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_234](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_234.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_232](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_232.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_248](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_248.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_246](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_246.jpg)
Les deux caseyeurs et les 6 doris sont prêt à retourner pêcher![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_251](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_251.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_252](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_252.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_253](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_253.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_254](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_254.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_255](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_255.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_257](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_257.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_258](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_258.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_262](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_262.jpg)
Je suis passé coté armateurs, près de la darse de la Royale![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_260](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_260.jpg)
Le mat du nouveau patrouilleur des Affaires Maritimes !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_261](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_261.jpg)
L'ex palangrier Ile de la Réunion bien sur !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_263](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_263.jpg)
De plus près !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_265](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_265.jpg)
Difficile de le comparer à l'Osiris qui termine sa vie par deux beaux sauvetages du coté de l'ile d'Amsterdam![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_264](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_264.jpg)
L'Austral vu de l'arrière !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_266](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_266.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_267](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_267.jpg)
Aujourd'hui caseilleur congélateur mais, visiblement chalutier par l'arrière précédemment![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_268](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_268.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_270](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_270.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_269](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_269.jpg)
Bon, si vous ne connaissez pas l'Austral maintenant, je me poserais des questions !
En complément, l'article publié le 24 avril 2012 par Le Bateau Immobile
Un an dans les Terres Australes & Antarctiques Françaises, sur le District de Saint Paul et Amsterdam. 550.000 km carrés, mais seulement 62 km² de terres, prises d'assaut par les vagues de l'Océan Indien, encore et toujours, comme un bateau immobile. A la limite des 40ièmes, je vous raconte mon quotidien de Chef de District sur ce blog. En espérant qu'il vous fasse découvrir ce petit bout de France inconnu, et vous donne l'envie de voyager, ici ou ailleurs ...
Adieu à l'Austral
Grand événement aujourd’hui à Amsterdam : l’Austral, seul et unique bateau de pêche autorisé à travailler dans la ZEE arrête sa campagne de pêche et reprend la route de la Réunion. C’est la fin de la saison de la langouste et la bouée de passage officielle vers l’hiver.
En six mois de présence (de novembre à avril), l’Austral est devenu une composante majeure de la vie du District. Les passages devant la cale de ses canots, les comms radio, les échanges de bons procédés, les échanges alimentaires, mais aussi les trois évacuations sanitaires sont autant d’occasions de mesurer que les pêcheurs et hivernants sont mutuellement indispensables.
Le moins que l’on puisse dire est que la solidarité des gens de mer n’est pas un vain mot. Nous avons parfois partagé avec le capitaine nos impressions sur nos métiers respectifs. Je ne crois pas que nous échangerions nos places, ni lui ni moi. Il y a de grandes similitudes entre les deux métiers, à ceci près que le mien s’exerce dans des conditions autrement plus confortables. Pour le reste, c’est assez proche, avec les mêmes problèmes de gestion de groupe, d’atteintes des objectifs, les mêmes plaisirs, les mêmes petites faiblesses à traiter. Même solitude. Les marins qui montent à bord de l’Austral sont un peu les aristocrates de la pêche réunionnaise, un peu comme les hivernants présents ici sont des privilégiés, même si nous l’oublions parfois. Là où vous ne verrez sans doute qu’un navire fatigué par une mer hostile, aux innombrables coulées de rouille le long des flancs, j’imagine une étrave qui avance dans des zones où peu ont le privilège d’aller.
On ne dira jamais assez la dureté du grand métier (« le grand métier » est le titre d’un livre de Jean Recher, journal de bord d’un capitaine de pêche de Fécamp sur les grands bancs de Terre Neuve, lecture que je ne peux que recommander). C’est la pêche qui commande, de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine, et le plus souvent dans des conditions de mer difficiles. Le milieu est dur, la mer est dure, et l’outil qu’est ce bateau est exigeant.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Austra10](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/austra10.jpg)
La pêche à la langouste est assez simple : l’Austral met à la mer ses caseyeurs, le plus souvent pour une grosse demi-journée … ou plus. Ces embarcations mettent à l’eau les casiers (des centaines de casiers !) tantôt dans des eaux profondes, tantôt plus près des côtes.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Austra11](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/austra11.jpg)
A proximité des côtes, les langoustes sont plus petites (attention au gabarit, on ne pêche pas n’importe quoi !) et d’un goût plus délicat. Plus profondément (entre 100 et 200 mètres), on ne pêche que des langoustes adultes, au goût plus affirmé. Si le sort le veut bien, quelques zorites (poulpes) seront aussi remontés dans les casiers. On met à l’eau, on immerge les casiers, on remonte, on transfère le contenu des casiers dans la cale, on remet à l’eau, on vide le caseyeur, on repart récuperer les casiers. Passer la journée sur un canot ou un caseyeur n’a rien d’une sinécure : en gros, ces embarcations sont aussi profilées d’une boite à savon, à la différence près que la baignoire, c’est l’Indien sud. Bateau utilitaire, l’important est la petite cale, le reste est conçu autour. Peu encombrant, on suppose qu’il roule abominablement dès que la houle est par le travers. Mais son aspect très compact doit le rendre très résistant aux vagues.
La pêche au sein des TAAF est très réglementée, que ce soit sur les volumes ou sur la qualité. Le quota est fixé au global à 400 tonnes. Là où le jeu se complique, c’est qu’il existe des quotas entre zones côtières et eux profondes, entre Amsterdam et Saint Paul. Mais le patron du bord doit aussi composer avec la demande, car comme toujours le marché dicte ses conditions. Langoustes entières cuites ou crues, ou conditionnées en queues, le succès de la prise dépend aussi de cette adéquation. Il y a en outre un cahier des charges drastiques sur les aspects environnementaux : traitement des déchets à bord, gestion des fluides, hydrocarbures, sans parler de l’interdiction de poser le pied sur Saint Paul. La transformation se fait directement sur le bateau, cuisson le cas échéant et congélation, jusqu’à la mise sous film plastique. La perte est d’environ un tiers en poids entre une langouste entière et une queue. Nous sommes loin de l’époque héroïque où moyennant le versement d’une somme rondelette, n’importe qui ou presque pouvait obtenir une concession. La gestion de la ressource est la clé de voute du système, et accessoirement une source de financement importante pour les TAAF.
Le peu de poisson que fait l’Austral est lui aussi très surveillé. Que ce soit les espèces (l’excellente fausse morue ou le toujours spectaculaire cabot de fond par exemple) ou là encore les quantités, la ressource halieutique fait comme la langouste l’objet de rapports réguliers envoyés par le Commissaire aux Pêches embarqué à bord des navires. C’est valable ici comme sur les autres districts pour en particulier la légine. Pour préciser un point (ça peut paraître surprenant mais un hivernant m’a posé la question tout récemment, et après tout il n’y a pas de questions idiotes, seules les réponses le sont parfois), il n’y a pas de chalutier dans les ZEE des Terres Australes, que des palangriers. La palangre, c’est un peu la pêche à la ligne industrielle, avec des lignes et des hameçons, là où le chalut est un aspirateur, qui prend tout sans discernement (vous avez tous vus ces images de requins, dauphins, requins baleines, barracudas, pris dans des filets) avec une gestion catastrophique de la ressource et des taux de rejet hallucinant, parfois proches de 80 %. Les filets longs d’une dizaine de kilomètres sont la mort programmés des océans. Le problème avec la palangre est le danger pour les oiseaux qui plongent pour manger les appâts. La mise à l’eau des lignes la nuit est l’une des solutions identifiées pour régler le problème.
L’heure n’est plus aux chiffres puisque la campagne prend donc fin avec le mois d’avril. Bientôt, les langoustes partiront vers le Japon ou les Etats-Unis, et les marins poseront le sac avant de se préparer pour une nouvelle campagne dans six mois.
Derniers saluts, dernières discussions, dernier repas pris ensemble, derniers rires, ce soir, le navire est déjà loin. Avec l’annulation d’une escale d’un autre navire prévue en mai, nous sommes à cette heure un peu loin du reste du monde que nous ne l’étions ce matin. Le bateau immobile continue sa course.
LMGB
photos : 100 % LMGB, Austral devant la cale en fin de campagne, chargement des casiers, langoustes d'Amsterdam

Bureaumachine busset- MATELOT

- Age : 67
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 MECANEQUI](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/MECANEQUI.jpg)

- Message n°338
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Alain ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) sympa reportages photos explications
sympa reportages photos explications
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) sympa reportages photos explications
sympa reportages photos explications 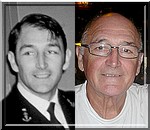
PAUGAM herve- QM 1

- Age : 80


![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Monite10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/monite10.gif)
- Message n°339
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Merci pour photos et explications, Alain ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)

(Pierre Dac)
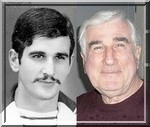
sad5- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 73


- Message n°340
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 588638](/users/2913/33/99/84/smiles/588638.gif) Alain, excellent reportage, tout est bon, même les crevettes
Alain, excellent reportage, tout est bon, même les crevettes ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 315838](/users/2913/33/99/84/smiles/315838.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 642994](/users/2913/33/99/84/smiles/642994.gif)

† COLLEMANT Dominique- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 77


- Message n°341
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Merci Alain pour cette série que j'aime bien . ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
Sur la 2ème photo de l'Autral , à quoi peuvent servir toutes ces antennes au-dessus de la passerelle ?
On dirait un navire espion.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
Sur la 2ème photo de l'Autral , à quoi peuvent servir toutes ces antennes au-dessus de la passerelle ?
On dirait un navire espion.
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanreconnaissance](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/rubanreconnaissance.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insign10](https://i.servimg.com/u/f58/15/16/88/33/insign10.gif)
Maître Principal mécanicien Collemant , dit "Bill" dans la sous-marinade / Membre de la section A.G.A.S.M. "Espadon" du Havre / Membre du M.E.S.M.A.T. de Lorient .
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Floreb10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/floreb10.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Maistr10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/maistr10.jpg)
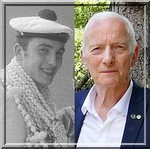
Charly- OFFICIER EN SECOND

- Age : 70
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Commis](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/commis.jpg)

- Message n°342
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Toujours un plaisir d'avoir des nouvelles du port de la Réunion. ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
Merci Alain.![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 642994](/users/2913/33/99/84/smiles/642994.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
Merci Alain.
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 642994](/users/2913/33/99/84/smiles/642994.gif)
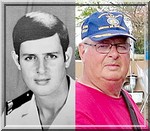
alain EGUERRE- MAÎTRE

- Age : 74


- Message n°343
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Nous sommes coté des armements des Kerguelen
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d85](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d85.jpg)
En face la darse Foucque de la Marine Nationale
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d85](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d85.jpg)
En face la darse Foucque de la Marine Nationale
- Spoiler:
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d89](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d89.jpg)
Rantanplan à reconnu Luky luke![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d84](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d84.jpg)
Suivons Francis vers l'Austral![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d86](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d86.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d87](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d87.jpg)
Pavillon de la Sapmer et de la Réunion !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d90](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d90.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d93](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d93.jpg)
Visiblement l'Austral est paré pour sa première campagne de pêche de l'été Austral !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d91](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d91.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d96](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d96.jpg)
La dernière baleinière est parée à embarquer sur l'Austral![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d94](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d94.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d95](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d95.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d97](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d97.jpg)
L'Albatros a terminé sa vie active !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d98](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d98.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_d99](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_d99.jpg)
Deux sauvetages de navigateurs autour du monde à son actif pour sa dernière sortie dans les TAAF![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_271](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_271.jpg)
L'ile de la Réunion 2 flambant neuf remplace l'Ile de la Réunion de la Comata en remplacement de l'Osiris comme patrouilleur maritime des TAAF et iles éparses !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_272](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_272.jpg)
On a fait le tour du bassin![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_274](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_274.jpg)
L'Austral et ses deux annexes !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_275](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_275.jpg)
A bloc de casiers pour la langouste de Saint Paul et Amsterdam !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_277](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_277.jpg)
Les deux caseilleurs annexes parés à embarquer !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_278](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_278.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_276](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_276.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_279](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_279.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_281](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_281.jpg)
Je reconnais un de mes casiers neufs piqués à Groix![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_280](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_280.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_284](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_284.jpg)
Détails, on aperçoit des casiers au dessus !![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_283](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_283.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_286](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_286.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_287](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_287.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_285](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_285.jpg)
L'Ile de la Réunion 2![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_289](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_289.jpg)
Le Saint André![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_290](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_290.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Port_288](https://i.servimg.com/u/f26/17/35/91/10/port_288.jpg)
Un dernier regard sur le Malin et on rentre à Petite Ile![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 580511](/users/2913/33/99/84/smiles/580511.gif)
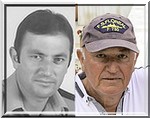
JACQUEZ- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 74
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Missilierasm](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/missilierasm.jpg)

- Message n°344
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Merci Alain pour ces nouvelles du port ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)

Bureaumachine busset- MATELOT

- Age : 67
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 MECANEQUI](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/MECANEQUI.jpg)

- Message n°345
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Alain ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) superbes reportages
superbes reportages
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif) superbes reportages
superbes reportages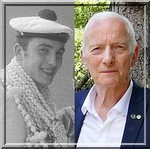
Charly- OFFICIER EN SECOND

- Age : 70
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Commis](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/commis.jpg)

- Message n°346
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Sacré Alain.par alain EGUERRE Aujourd'hui à 15:56
Rantanplan à reconnu Luky luke
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238947](/users/2913/33/99/84/smiles/238947.gif)
Merci pour les nouvelles du port de la Réunion.
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
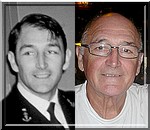
PAUGAM herve- QM 1

- Age : 80


![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Monite10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/monite10.gif)
- Message n°347
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Ce Rantanplan, Alain, me rappelle beaucoup mon regretté pépère Otar
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238874](/users/2913/33/99/84/smiles/238874.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 238874](/users/2913/33/99/84/smiles/238874.gif)

(Pierre Dac)

† COLLEMANT Dominique- MAÎTRE PRINCIPAL

- Age : 77


- Message n°348
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Merci Alain. ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)

![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanreconnaissance](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/insignes/rubanreconnaissance.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insign10](https://i.servimg.com/u/f58/15/16/88/33/insign10.gif)
Maître Principal mécanicien Collemant , dit "Bill" dans la sous-marinade / Membre de la section A.G.A.S.M. "Espadon" du Havre / Membre du M.E.S.M.A.T. de Lorient .
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Floreb10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/floreb10.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Maistr10](https://i.servimg.com/u/f26/13/76/08/76/maistr10.jpg)

loulou06000- PREMIER MAÎTRE

- Age : 70


- Message n°349
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Merci Alain pour ces belles photos toujours aussi colorées et lumineuses
Sur la 1ere et deuxieme photos j'ai reconnu le quai à gauche sur la photo ou j'ai fait 3 fois escale avec des batiments differents.
L'Astral ressemble plus à un bateau espion qu'à un bateau de peche (genre chalutier sovietique)!![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
Sur la 1ere et deuxieme photos j'ai reconnu le quai à gauche sur la photo ou j'ai fait 3 fois escale avec des batiments differents.
L'Astral ressemble plus à un bateau espion qu'à un bateau de peche (genre chalutier sovietique)!
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 595882](/users/2913/33/99/84/smiles/595882.gif)
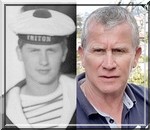
dan83143- QM 1

- Age : 66


- Message n°350
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Re: [Vie des ports] Les ports de la Réunion
Belles photos, ![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 762739](/users/2913/33/99/84/smiles/762739.gif) Alain
Alain
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 582735](/users/2913/33/99/84/smiles/582735.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 762739](/users/2913/33/99/84/smiles/762739.gif) Alain
Alain
Homme libre, toujours tu chériras la mer
La mer permet tout pourvu qu'on la respecte



![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Ruban11](https://i.servimg.com/u/f35/15/16/88/33/ruban11.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Fb210](https://i.servimg.com/u/f19/19/08/80/09/fb210.png)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Livreo10](https://i.servimg.com/u/f77/14/20/43/57/livreo10.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Liensamis](https://2img.net/h/acbpr.fr/cb/boutons/liensamis.jpg)


 par
par 
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanr11](https://i.servimg.com/u/f11/15/16/88/33/rubanr11.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insig206](https://i.servimg.com/u/f39/15/16/88/33/insig206.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Rubanr10](https://i.servimg.com/u/f58/15/16/88/33/rubanr10.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insign45](https://i.servimg.com/u/f39/15/16/88/33/insign45.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Marque10](https://i.servimg.com/u/f79/13/83/95/71/marque10.jpg)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 1011](https://i.servimg.com/u/f58/13/83/95/71/1011.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insig596](https://i.servimg.com/u/f62/15/16/88/33/insig596.gif)
![[Vie des ports] Les ports de la Réunion - Page 14 Insig503](https://i.servimg.com/u/f62/15/16/88/33/insig503.gif)

